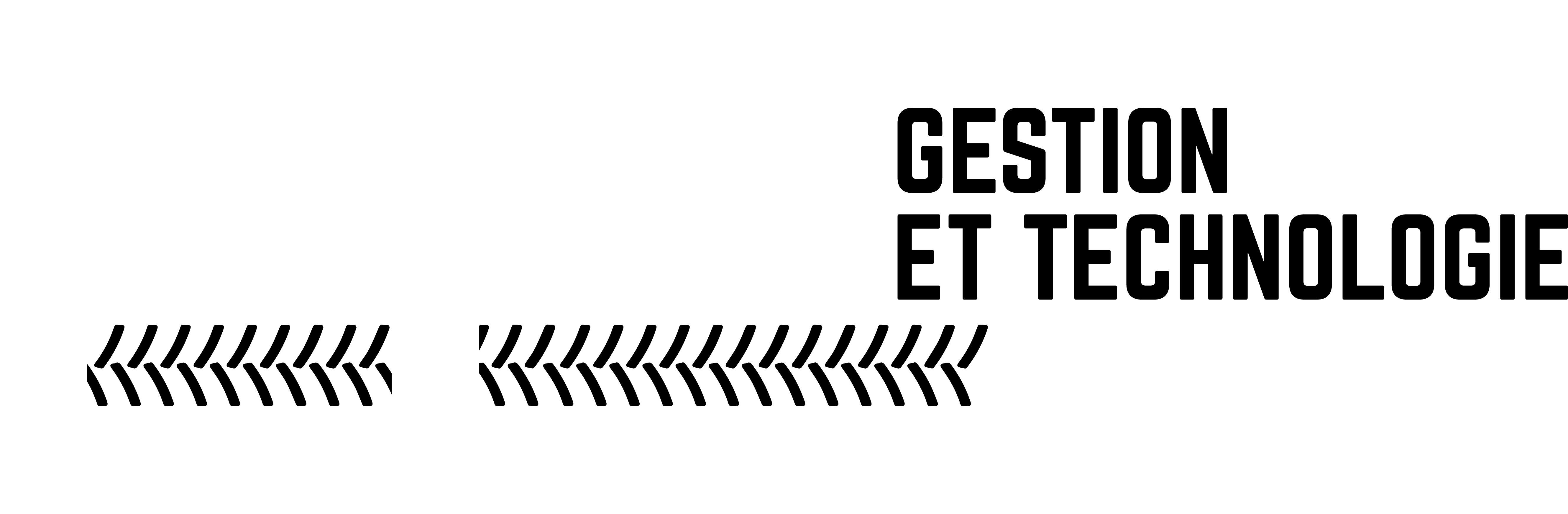Q1 – Peut-on identifier actuellement des tendances en matière de construction agricole, notamment au chapitre des matériaux?
Q2 – Qu’en est-il de la division des espaces au sein des bâtiments qui accueillent des cheptels? Quel est l’impact des nouvelles normes en matière de bien-être animal à cet égard?
Q3 – La construction, l’agrandissement, la modernisation ou l’adaptation d’un bâtiment agricole représente souvent un investissement considérable. Les producteurs agricoles et agroalimentaires construisent-ils plus grand ou plus petit qu’il y a 25 ou 30 ans? Mesure-t-on en amont de projet l’impact de la construction sur la valeur globale de la ferme?
Q4 – Concrètement, en quoi les changements apportés à la Loi sur les architectes et à la Loi sur les ingénieurs ont-ils modifié votre manière de travailler?
Q5 – Un projet réalisé dont vous êtes particulièrement fier?
Alexandre Joubert
Constructions J.C. Élite | Roxton Falls

Photo : gracieuseté
Q1 – On note une forte tendance pour les matériaux durables et faciles d’entretien, tels l’acier galvanisé et l’acier prépeint, souvent combinés avec du bois. À l’intérieur, on trouve souvent du PVC lisse ou ondulé pour faciliter le lavage des installations et respecter les normes sanitaires. On les construit pour les 30, 40 années à venir.
Q2 – C’est bien différent d’autrefois. On ne parle plus simplement de quatre murs et un toit, mais bien de circulation libre, de ventilation, de confort. Par exemple, pour la production laitière, il faut aujourd’hui prévoir des corridors de circulation vers les robots de traite, des zones de repos, des aires de vêlage et des systèmes d’alimentation adaptés, etc. L’objectif est de conférer un meilleur mode de vie aux animaux et de contribuer à l’efficacité des producteurs.
Q3 – On construit actuellement plus grand. Le nombre de pieds carrés nécessaires pour une vache est beaucoup plus important de nos jours. Les agronomes et les accompagnateurs bancaires associés aux projets visent, en amont, à ce que chaque pied carré d’un projet soit justifié et productif. Je dirais que l’on construit actuellement de 75 % à 100 % plus grand, et ce, pour le même nombre de bêtes.
Q4 – Cela a contribué à une collaboration accrue avec ces professionnels, même si notre entreprise était déjà bien familière avec ces méthodes et pratiques puisque nous œuvrons aussi dans le résidentiel et le commercial. Je suis d’avis que l’implication d’ingénieurs agricoles dans le processus est une excellente chose. Toutes les parties en sortent gagnantes.
Q5 – Plusieurs me viennent en tête, mais j’irais pour le projet que nous terminons présentement à Sainte-Angèle-de-Monnoir, celui de la Ferme Clauberg, un complexe laitier de plus de 30 000 pi2 intégrant trois robots de traite. Il a fallu agir rapidement dans ce dossier à la suite de l’incendie du bâtiment l’an dernier. Nous avons tenu des réunions de chantier en amont avec tous les corps de métier, question de bien coordonner les opérations afin de nous suivre un après l’autre. L’objectif : constituer le seul interlocuteur afin de bien mener le projet à terme.
Richard Deslandes
Constructions Deslandes | Saint-Liboire

Photo : gracieuseté
Q1 – De plus en plus, les assureurs demandent à ce que les bâtiments soient résistants aux incendies et aux importantes charges de neige et de vent. On note aussi une tendance du côté du facteur d’efficacité énergétique d’un bâtiment depuis les dernières années. Ça représente un plus grand investissement, mais il est possible de réaliser des économies sur la durée.
Q2 – Les nouvelles normes en matière de bien-être animal exigent, entre autres, la circulation libre pour les vaches et le détassement des volailles. Ça demande davantage d’espace, donc un investissement plus important.
Q3 – Ils optent pour construire plus grand. Cela s’explique par le fait qu’il y a moins de producteurs pour une demande souvent croissante. Ceux qui restent font le choix d’agrandir leurs installations. Par exemple, pour les grandes cultures, acquérir de nouveaux équipements nécessite davantage d’espace garage et ainsi de suite.
Q4 – Puisqu’un ingénieur et un architecte signent des plans de construction, notre travail consiste désormais à réaliser le concept pour le client, pour les assureurs. Les calculs de fondation et l’élaboration de la structure sont davantage figurés. Cela a simplifié le travail puisque tout le monde suit le même plan.
Q5 – Il y en a plusieurs. Je citerais, dans la volaille, des projets réalisés pour Sollio, Boire & Frères et la Famille Ménard, qui est passée depuis dans le giron d’Olymel.
Luc Trahan
Consumaj | Saint-Hyacinthe

Photo : gracieuseté
Q1 – On note de plus en plus de produits plastifiés dans l’agricole et dans les poulaillers et de la tôle commerciale, plus résistante, comme celle employée dans les toitures à faible pente. Le bois d’ingénierie est aussi populaire, mais le nouveau Code de construction du Québec, qui entrera en vigueur en 2026, pourrait changer la donne, notamment en rapport avec les charges latérales liées au sismique et relatives aux normes d’ossature légère et de bâtiments multi-étages.
Q2 – Si l’on parle de volaille, la tendance est à l’élimination des divisions au profit de zones grillagées. Pour rappel : le Code de construction 2020 limitait les espaces à 4800 m2, ce qui ne sera plus le cas dès octobre 2026. Du côté de l’élevage, exception faite de la zone de vêlage, c’est désormais plus ouvert que fermé en matière d’espace, de division.
Q3 – Définitivement plus grand. Vu les nouvelles normes d’élevage, les producteurs n’ont pas le choix. La superficie de l’ensemble des bâtiments d’élevage a facilement doublé, sinon plus, au cours des dix ou quinze dernières années. L’impact sur la valeur de la ferme ne sera pas immédiat, car la plupart du temps, investir dans un agrandissement signifie un prêt, une dette.
Q4 – Le fait de ne plus pouvoir émettre de plan ou de devis avant l’architecte constitue probablement le plus grand impact, ce qui demande davantage de temps qu’auparavant. Cela dit, l’architecte spécifie le principe de résistance au feu par rapport aux limites de propriété. Par exemple, dans un cas donné, pour qu’un bâtiment bénéficie d’une résistance d’une heure, on doit appliquer quatre couches de gypse de type X. C’est assez impressionnant.
Q5 – La Ferme Mystique, actuellement en construction à Mirabel, en est certainement un. Il s’agit d’un projet en bois d’ingénierie, plus précisément une étable à stabulation libre intégrant un carrousel de traite, qui vise la limite permise en matière de superficie, soit d’environ 4700 pi2. Un beau projet avec de bons propriétaires et une belle relève.