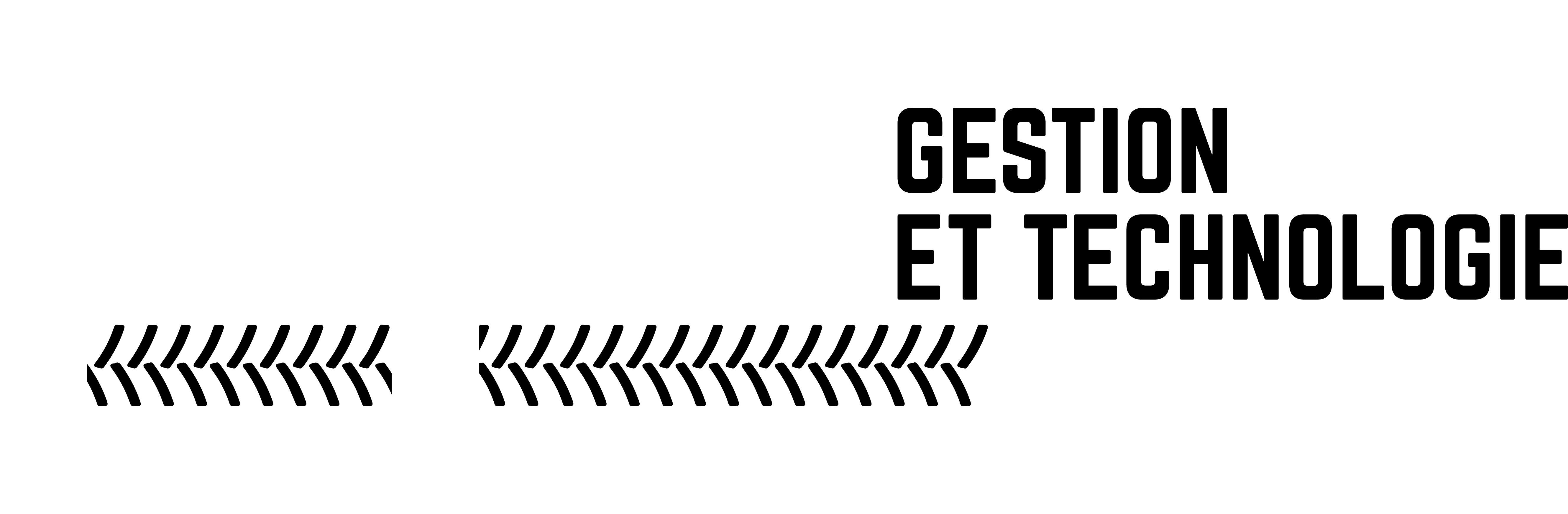Le bilan des profils
L’année dernière, j’ai eu le privilège de collaborer avec des partenaires sur des projets collectifs et d’accompagner des conseillers dans la réalisation de profils de sol chez des entreprises agricoles. Au total, nous avons creusé plus de 60 profils, tous différents les uns des autres. La Montérégie présente une grande variabilité dans ses groupes de sol, allant des sols sableux de la région d’Acton aux argiles de Varennes, en passant par les terres noires de Napierville. Chaque profil de sol révèle sa propre histoire et c’est à nous, les conseillers et les producteurs, de prendre le temps de les comprendre afin de maintenir et même d’augmenter leur potentiel agricole. Pour moi, il n’y a pas de mauvais sol. Par contre, certains nécessitent plus d’attention et de précautions puisque c’est plus facile de les endommager que de les améliorer.
Du temps pour aller creuser et comprendre
Il est recommandé d’inclure dans les opérations annuelles de tout producteur agricole la réalisation d’un profil de sol, non seulement pour effectuer un réel diagnostic, mais aussi pour déterminer la profondeur de travail de son équipement. On n’a pas toujours besoin de creuser très profondément. À l’automne, par exemple, lors des travaux de sol plus lourds, il faut s’assurer de travailler la zone endommagée par le passage de la machinerie et pas seulement les premiers centimètres du sol. Quelques coups de pelle permettent de connaître la profondeur à travailler et l’humidité du sol à la profondeur du travail.
Un diagnostic pour raffiner la stratégie à implanter
Bien que les diagnostics ne donnent pas toujours les résultats espérés par les producteurs, ces derniers en retirent un apprentissage et une satisfaction de mieux comprendre les problèmes dans leur champ. Le plus dur reste à faire, soit d’implanter une stratégie à court, à moyen et à long terme qui viendra assurer la résilience des sols de l’entreprise, ainsi que d’en assurer un suivi serré durant la transition.
Des sols argileux qui ont besoin d’amour
Dans les dernières années, on a beaucoup parlé de la compaction de profondeur et de ses conséquences dévastatrices sur les sols. Cependant, il ne faut pas négliger la compaction de surface (dans les 30 premiers centimètres), qui aura une incidence importante sur la germination des semences, la croissance des racines de même que l’accès à l’eau – et surtout à l’air – pour les racines et les microbes du sol. J’ai observé dans la dernière année que beaucoup de champs avaient une belle structure grumeleuse dans les cinq premiers centimètres en raison du travail mécanique réalisé au printemps, mais que, juste en dessous, la structure devenait très dense, avec peu de porosité et de vie (photo 2).
Des racines trop peu nombreuses
Les systèmes agricoles sont vivants, grouillants de vie. L’oxygène est l’élément le plus important pour la vie dans le sol et la croissance des plantes. Le moment idéal pour creuser un profil, c’est lorsqu’il y a des racines vivantes dans le sol. Grâce à celles-ci, on peut mieux comprendre comment l’air et l’eau circulent sous terre. De manière générale, j’ai constaté que nos cultures commerciales tendent à faire moins de petites racines et concentrent leur énergie sur de grosses racines, surtout dans les 30 premiers centimètres du sol. On peut penser que cela est dû au fait que la porosité du sol est réduite par la compaction, donc les racines utilisent les macropores et les fentes de retrait pour pousser (photo 3).
Les objectifs en 2025
Les changements climatiques se font déjà ressentir depuis quelques années au Québec. Les sols agricoles peuvent être une solution pour atténuer les conséquences qui y sont liées. Pour cela, on doit améliorer leur santé et leur résilience en adoptant des pratiques de conservation comme les cultures de couverture, les rotations longues et diversifiées et le travail minimum du sol. De plus, une attention particulière doit être portée sur la compaction de surface et de profondeur.
Ces bonnes pratiques doivent cependant être intégrées graduellement dans les entreprises agricoles, en suivant le rythme du sol et sa capacité à gérer le changement. Pour une transition réussie, les entreprises doivent être accompagnées. Les membres de l’équipe santé des sols du MAPAQ sont prêts à fournir cet accompagnement au champ aux conseillers et aux producteurs. Les connaissances sont là, les solutions existent, il ne faut qu’une étincelle dans le cœur d’un producteur pour que les solutions s’enclenchent à la ferme.