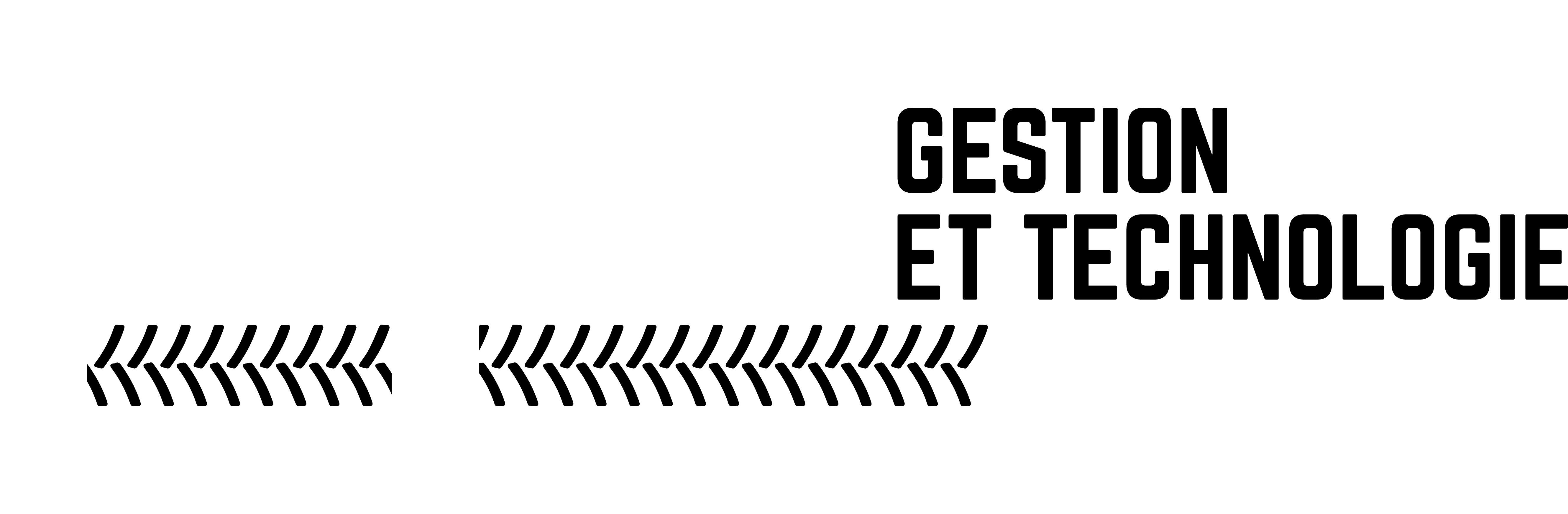Choix des espèces fourragères pérennes
Vos superficies ensemencées serviront-elles de foin de commerce, de fourrages cultivés pour vos vaches laitières ou de pâturages pour vos ruminants? Le type d’utilisation, l’objectif (rendement ou valeur nutritive), la durée de vie recherchée et les caractéristiques du sol (type, profondeur, drainage, fertilité et pH) détermineront la composition botanique de vos prairies.
La sélection du mélange fourrager doit également tenir compte des caractéristiques spécifiques des espèces et des cultivars : vitesse de croissance, stade idéal pour la fauche, appétibilité, potentiel de rendement, persistance et résistance à l’hiver. Cela permettra d’obtenir une certaine synchronicité de la maturité des plantes, de maximiser le rendement et d’assurer une bonne valeur nutritive du fourrage.
Les mélanges fourragers contenant des légumineuses permettront d’accroître la teneur en protéines; ils réduiront aussi les besoins en azote et assureront un rendement lors des périodes chaudes de l’été. Quant aux graminées pérennes, elles augmenteront la longévité de votre prairie. La proportion de légumineuses a tendance à diminuer au fil des ans, laissant plus de place aux graminées, qui rivaliseront avec les mauvaises herbes. Le type d’utilisation de vos prairies peut ainsi évoluer à travers les années. Le choix des graminées fourragères est donc aussi important que le choix des légumineuses.
Combien d’espèces dois-je avoir dans mon mélange?
Les mélanges comprenant de deux à trois espèces ciblent généralement le rendement et la valeur nutritive. Les mélanges plus diversifiés, quant à eux, ciblent la résilience, la persistance, la stabilité dans les rendements et les services écosystémiques : biodiversité, séquestration du carbone, structure du sol, etc. Dans un mélange de trois espèces, il est suggéré de choisir une légumineuse et deux graminées. Dans un mélange de quatre à six espèces, on vise aussi à avoir de 30 % à 50 % de légumineuses. Comme il est mentionné plus haut, la proportion des espèces aura tendance à évoluer avec les années en fonction des conditions du sol, de sa fertilité, du cycle de vie des espèces, de la gestion des coupes ainsi que des perturbations climatiques et biotiques. Il faut également éviter d’avoir une rivalité trop élevée dans le mélange puisque certaines espèces auront de la difficulté à s’implanter et à persister. Par exemple, une espèce lente à s’établir comme le lotier ne doit pas être mélangée à des espèces très compétitives dans leur établissement comme la fétuque ou le dactyle. Si un tel mélange est utilisé, il faut établir des stratégies comme diminuer la dose de semis des espèces les plus compétitives.
Pourquoi acheter des semences certifiées?
Lorsque vient le temps de commander des semences, il est tentant d’acheter les semences ordinaires (ou communes), car celles-ci sont moins chères. Mais est-ce réellement une économie? Avec les semences ordinaires, le pourcentage de germination n’est pas garanti et elles peuvent être contaminées par des graines de mauvaises herbes ou d’autres plantes cultivées. Certains semenciers classent eux-mêmes leurs semences de type ordinaire et les vendent sous leur propre marque de commerce. Cela ne garantit pas le même niveau de contrôle de qualité que la certification émise par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Ne sachant pas exactement ce que contient le sac, vous jouez à un jeu de hasard lors du semis.
Il est plutôt recommandé de choisir les semences de fourrages certifiées. Cela ne date pas d’hier que les conseillers recommandent l’achat de ce type de semences.
MM. Réal Michaud et Lucius Belzile, agronomes et pionniers dans le domaine des plantes fourragères au Québec, ont publié un article sur le sujet dans Le Bulletin des agriculteurs en février 1983. Ils mentionnaient que « la supériorité des semences pédigrées ne fait aucun doute… Un investissement additionnel au moment de l’achat des semences peut rapporter gros lorsque viendra le temps de récolter ».
Les étiquettes bleues apposées sur les sacs sont bien méritées. Avant d’arriver chez votre fournisseur, ces semences ont été l’objet d’environ 15 ans de recherche, de développement et de sélection pour ensuite passer des tests stricts d’un tiers autorisé par l’ACIA. La certification des semences garantit :
– la pureté variétale,
– le taux de germination,
– l’absence d’impuretés (graines de mauvaises herbes et autres espèces),
– une meilleure résistance aux maladies, aux insectes et à l’hiver,
– l’uniformité des lots de semences et de la maturité.
Lors d’essais, MM. Michaud et Belzile ont observé un rendement supérieur de 30 % avec l’utilisation de semences certifiées de trèfle rouge en comparaison avec l’utilisation de semences ordinaires de la même espèce (figure 1). De plus, la garantie d’un taux de germination permet d’avoir un meilleur recouvrement du sol. Cela réduit la présence de mauvaises herbes, qui n’attendent qu’un espace libre pour pousser. Compte tenu de la durée de vie de votre prairie, le coût des semences certifiées lors de son établissement est un petit investissement : il augmente le taux de réussite de vos implantations en plus d’offrir la certitude quant à sa productivité et à la qualité des fourrages. Alors, pourquoi ne pas accorder autant d’importance au choix de ses semences fourragères qu’au choix de ses cultivars de maïs?
Dans les guides de semences, plusieurs mélanges sont proposés. Analysez-les et discutez-en avec vos conseillers. S’ils ne conviennent pas à vos besoins, pourquoi ne pas créer votre propre mélange? Comme l’ont dit les agronomes Réal Michaud et Lucius Belzile en 1983, « l’affaire est dans le sac »!