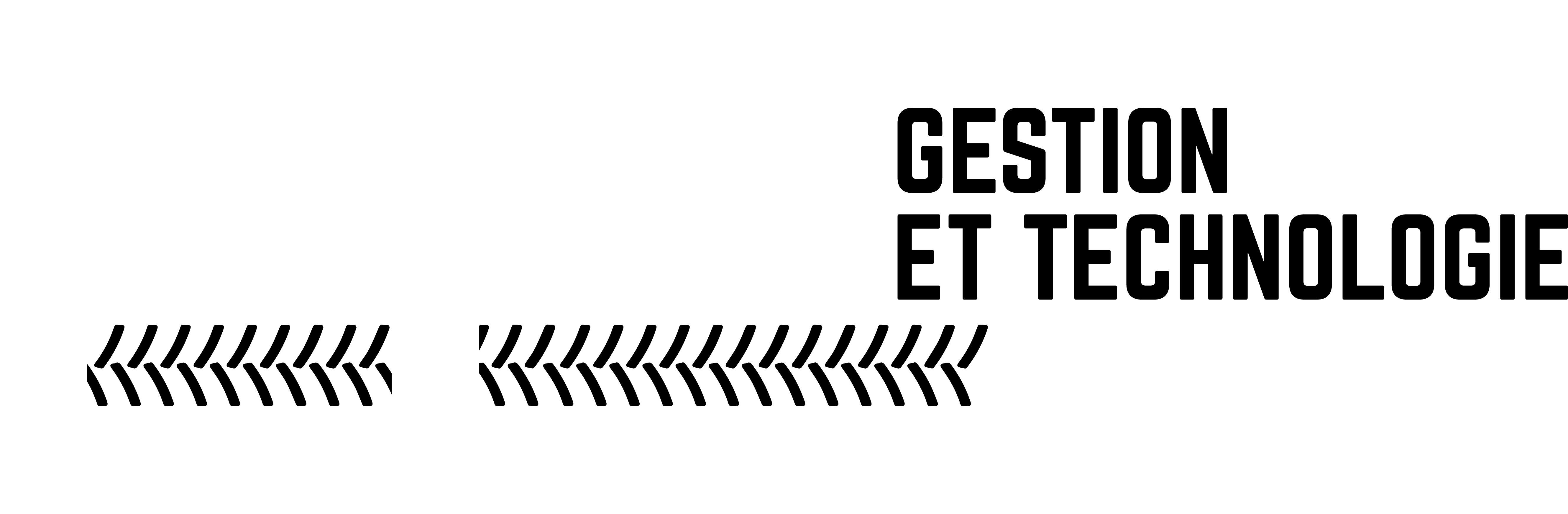Que peut-on faire pour s’adapter aux événements climatiques extrêmes? Il y a plusieurs lignes de défense. La couverture des sols par des plantes ou des résidus est primordiale pour diminuer l’érosion dans les champs. Les bandes riveraines bien implantées contribuent à maintenir les berges stables et résistantes. Cependant, malgré des efforts sur ces deux fronts, la nature est puissante. Il faut parfois faire venir du renfort et aménager des ouvrages hydroagricoles.
Les ouvrages hydroagricoles les plus courants sont les protections enrochées. Cette catégorie regroupe principalement les sorties de drain et les déversoirs enrochés. La pierre est plus résistante à l’érosion que le sol; les travaux consistent donc à excaver, à installer un géotextile et à placer la pierre à l’endroit où se trouvait le sol. Le rôle du géotextile est de séparer le sol de la pierre. Il contribue aussi à la résistance de l’ouvrage.
Voici les points cruciaux pour réussir un déversoir enroché :
– Localiser le déversoir au bon endroit, dans le point le plus bas du champ, où l’eau sort de façon concentrée et où il y a un bris du talus.
– Déterminer les dimensions du déversoir selon le bassin versant, le débit de pointe et l’ampleur du bris.
– Réaliser des clés d’ancrage en haut et en pieds de talus, c’est-à-dire surexcaver et remplir de pierres, pour augmenter la stabilité.
– Aménager des risbermes, soit des butes de terre d’environ 30 cm de hauteur, afin de diriger l’eau vers le déversoir enroché et s’assurer qu’elle l’emprunte.
– Ensemencer le sol rendu à nu par les travaux.
Une autre façon de contrôler l’érosion est de canaliser l’eau. En effet, l’eau qui circule dans un tuyau ou un drain, plutôt qu’à la surface du sol, ne l’érode pas. Les ponceaux-avaloirs et les avaloirs en site pentu font partie de cette catégorie. Ils sont toujours couplés à un bassin de sédimentation ou d’attente. D’un point de vue économique, il est pratiquement impossible de poser un tuyau suffisamment gros pour canaliser tout le débit de pointe, donc le bassin permet à l’eau d’attendre son tour avant de passer dans le tuyau. Les bassins permettent aussi à une partie des particules de sol transportées par l’eau de se déposer. Il faut donc nettoyer les bassins régulièrement, car ils se remplissent. Les avaloirs en site pentu sont souvent jumelés à une voie d’eau engazonnée, ce qui diminue la fréquence de vidange des bassins et surtout, diminue l’érosion en ravine dans le champ. Dans tous les cas, étant donné qu’une partie de l’eau n’est pas canalisée lors de forts événements pluvieux, il faut protéger la sortie avec un déversoir enroché.
Il existe d’autres ouvrages de conservation des sols, comme les seuils dissipateurs d’énergie dans les fossés à forte pente, l’enrochement de confluents, les rigoles d’interception, les voies d’eau enrochées et les grands bassins de sédimentation, par exemple. Dans tous les cas, ces travaux demandent de la préparation. Il faut prévoir l’emplacement des ouvrages, leurs dimensions et leurs caractéristiques. Un devis doit être préparé afin de connaître les coûts, de commander le matériel et la pierre et de retenir les services d’un entrepreneur en excavation. Les travaux doivent se faire par temps sec, la plupart du temps après les récoltes.
Les conseillers du MAPAQ peuvent vous accompagner. Contactez-les avant d’entreprendre les travaux. Ils pourront aussi vous fournir de l’information au sujet du programme Prime-Vert1, qui offre des aides financières par l’entremise du sous-volet 1.1.4 pour les projets favorisant l’optimisation de la gestion de l’eau.
1www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Prime-Vert.aspx