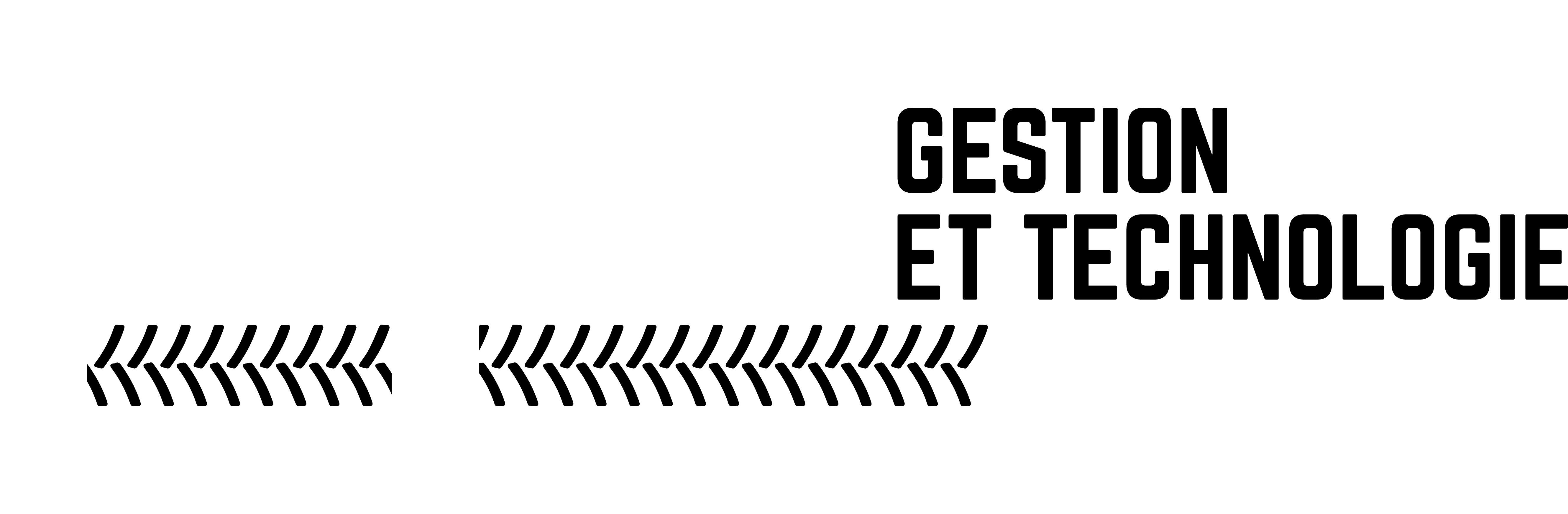GTA : Débutons par une présentation succincte du CDPQ.
Jacques Faucher : Il s’agit d’une création du MAPAQ, qui a décidé un jour de le rendre plus autonome il y a 32 ans. Il avait été créé pour réaliser la gestion des programmes liés à la génétique, à la santé, à l’analyse de troupeaux ainsi qu’aux épreuves d’évaluation de porcs commerciaux. Le CDPQ est aujourd’hui un centre d’expertise multidisciplinaire de type OBNL qui, par ses services, ses activités de transfert de connaissances et son implication dans plusieurs projets de recherche et de développement, contribue au dynamisme de l’ensemble de la filière porcine québécoise.
Par l’entremise des divers comités qu’il gère et de ses multiples collaborateurs et partenaires d’affaires, le CDPQ joue également un rôle de concertation ou de coordination auprès d’un grand nombre d’acteurs de l’industrie. Le CDPQ est un organisme parapublic qui a un chiffre d’affaires annuel variant entre 7 M$ et 8 M$. Notre budget de fonctionnement provient du MAPAQ à 25 %, d’une prime de 10 cents pour chaque porc abattu, soit 600 000 $ par année provenant des Éleveurs de porcs du Québec, et un 100 000 $ additionnel d’autres sources. Le reste provient de projets de recherche, qui constituent la base des activités du Centre, qui compte sept secteurs d’activités, dont la santé et la biosécurité, les bâtiments et la régie d’élevage, l’alimentation et la nutrition, la génétique, la qualité des viandes, l’économie et la gestion ainsi que l’analyse et la valorisation des données. À noter que, depuis quelques années, le CDPQ a développé une expertise multiespèces, plus particulièrement en génétique bovine, avec les Producteurs de bovins du Québec. Selon une entente avec le MAPAQ, une somme est perçue pour chaque bœuf abattu, somme réorientée vers le CDPQ pour permettre un levier financier afin d’obtenir des subventions pour des projets de recherche.
Autre exemple, notre équipe vient aussi supporter celle du Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) au niveau des services génétiques.
GTA : L’expertise développée dans l’industrie porcine vous permet donc d’intervenir dans plusieurs autres créneaux, dans des contextes spécifiques?
J.F. : Absolument. Par exemple, au chapitre des conditions d’ambiance pour les bâtiments d’élevages porcins, nous possédons une expertise étoffée en ventilation. Nos responsables contribuent régulièrement au transfert de savoir vers de grands réseaux privés d’élevage de volaille. , dans des contextes spécifiques?C’est également le cas pour la qualité des viandes et la génétique, secteurs pour lesquels l’expertise développée en production porcine est également appliquée pour d’autres productions anima-les, comme en production de bovins de boucherie et en production ovine. Il y a quatre ans, le Centre a construit une maternité de recherche et de formation à Armagh (région de Bellechasse), infrastructure financée à 90 % par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec.
Le troupeau compte 675 truies productives conduites en bande toutes les quatre semaines. Des projets de recherche et développement novateurs (publics et privés) y sont réalisés et les principaux objectifs sont de minimiser l’impact sur l’environnement en optimisant l’utilisation des ressources (énergie, eau, aliments, etc.); favoriser le bien-être des animaux et des éleveurs; optimiser le coût de production afin de favoriser la compétitivité des entreprises de la filière; développer et/ou valider des techniques, technologies et connaissances novatrices; et développer et/ou valider des solutions face à la pénurie de main-d’œuvre.
GTA : Un projet de construction et d’amélioration de la station de recherche de Deschambault est aussi en cours, exact?
J.F. : Oui, la construction de cette installation de recherche, au coût de 7 M$, est rendue possible grâce à l’appui financier à 90 % du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, dans le cadre du programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation, volet 4 (PSOV4). Il faut savoir que la station actuelle, propriété du CDPQ, a été construite en 1994 et qu’il s’agit au départ d’une pouponnière-engraissement de 360 places en gestion tout-plein, tout-vide. L’amélioration de la Station permettra de loger 192 porcelets et 684 porcs en engraissement.
Plusieurs équipements et installations seront ajoutés, notamment des systèmes d’alimentation de précision, des salles d’élevage permettant le suivi des conditions d’ambiance et un ostéodensitomètre permettant le suivi de la composition corporelle sur un porc vivant. Ces nouvelles installations modernes permettront des collaborations encore plus fructueuses avec les universités (McGill, Laval, UdeM), qui utilisent nos installations pour différents projets menés par leurs étudiants à la maîtrise et au doctorat, les partenaires privés et autres joueurs de l’industrie. On parle davantage de recherche appliquée, de projets dont les résultats peuvent être rapidement utilisés à la ferme.
Une expertise recherchée
GTA : Quels sont vos effectifs?
J.F. : Au CDPQ, il y a environ 50 employés permanents auxquels s’ajoutent, au besoin, des spécialistes pour des projets spécifiques.
Par ailleurs, il faut spécifier que le CDPQ est également propriétaire à 99 % du Centre d’insémination porcine du Québec (CIPQ) depuis 2021, jadis une propriété d’Investissement Québec, qui avait pour mission première de générer des profits. Le CDPQ et la filière porcine ont fait l’acquisition du CIPQ. Cette action s’inscrivait dans une volonté de conserver la propriété, l’expertise et les emplois au Québec, d’être compétitif, d’assurer un approvisionnement de semence porcine de qualité à l’ensemble des membres de la filière québécoise, partout sur le territoire et de garantir l’achalandage des « hébergés » actuels pour les années à venir.
J’agis en tant que directeur général du CIPQ depuis 2022. Je n’avais jamais pensé à quel point l’expertise du CDPQ serait reconnue à une si grande échelle après cette transaction. Mais, c’est bel et bien le cas.
GTA : Le succès de vos activités de recherche et de développement garantit une optimisation pour la filière, de la construction à l’élevage en passant par l’insémination, exact?
J.F. : Oui. Par exemple, l’objectif du CIPQ est de produire une dose de qualité, au meilleur prix, dose qui sera ensuite distribuée à l’ensemble des maternités du Québec. Pour ce faire, nos responsables du CDPQ ont revu les conditions d’ambiance des bâtiments, ce qui a contribué à une meilleure qualité de semence et à augmenter les délais de préservation des doses, passant de trois à quatre jours, comme officialisé le 1er novembre. Nos activités de recherche permettent donc de développer de nouvelles méthodes et pratiques de production.
Aussi, la valorisation des données est très importante au CDPQ, car elle permet une meilleure information et une meilleure gestion des opérations d’insémination. On investit aussi beaucoup dans la gestion de nos bâtiments et de la qualité d’ambiance pour les élevages du CIPQ. Par exemple, il nous a été possible de garder la température ambiante à 21 degrés Celsius dans nos trois sites en période estivale. Tous les réseaux de l’industrie ont constaté une hausse de qualité dans la semence prélevée en adoptant les méthodes issues de nos recherches et initiatives.
GTA : Un producteur vous contacte pour vous faire part d’un projet. Quel est le processus?
J.F. : Cela dépend du type de projet. Il nous est toujours possible d’avoir une discussion avec un producteur et d’analyser la faisabilité de son projet. Notre site Internet détaille bien nos expertises selon le besoin du projet. Il y trouvera les coordonnées de nos responsables des différents secteurs d’activités et pourra ainsi établir un contact. Il est possible de déterminer dans quel type de programme le projet risque d’obtenir des fonds, toujours en tenant compte de l’efficience de ce dernier en matière de temps et d’argent. Dans certains cas, le CDPQ utilise ses installations pour mener à bien les projets, dans d’autres cas, il arrive que le projet soit réalisé directement dans les installations du producteur.