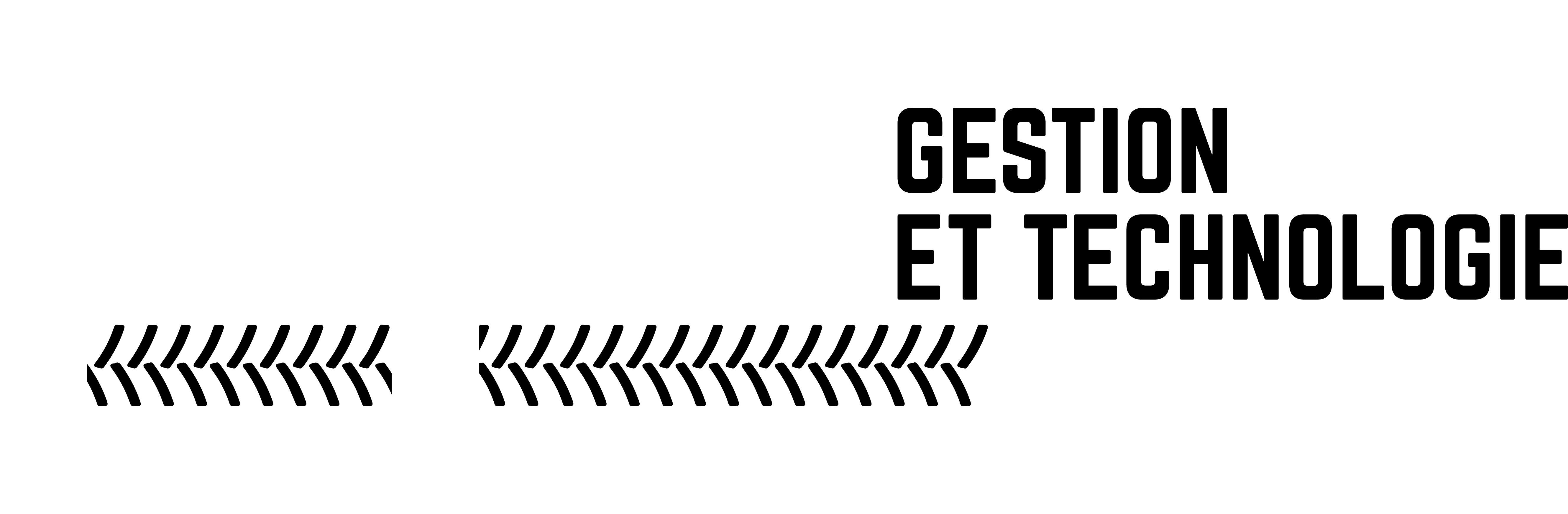Les dégâts causés par les conditions climatiques
Quand des vagues de chaleur caniculaire se produisent en juillet, elles viennent inévitablement avec des orages. L’action des pluies diluviennes et des forts vents à des stades de développement précis du maïs peut briser la tige au niveau d’un nœud Ce phénomène, appelé « green snap » ou « brittle snap » survient à deux périodes. Il apparaît d’abord entre les premiers stades de croissance active, lorsque la plante présente environ cinq à huit feuilles visibles. Il survient également plus tard, lorsque la plante compte une douzaine de feuilles, jusqu’à l’apparition des croix.
À ces stades, la tige s’allonge rapidement et perd en rigidité, car les parois cellulaires sont plus fragiles. On observe alors des plants cassés qui, quelquefois, reprennent leur croissance lorsqu’il reste une section de tige intacte. Toutefois, ils n’auront pas un aussi bon rendement que les plants intouchés. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce phénomène, notamment la sensibilité de l’hybride.
Les dommages faits par les ravageurs
Des problèmes liés à la présence d’insectes nuisibles peuvent aussi apparaître en juillet. Certains ravageurs s’attaquent aux parties souterraines des plantes, alors que d’autres affectent les parties aériennes. Les larves des chrysomèles des racines du maïs creusent des galeries dans les racines. Les dommages aux racines d’ancrage affaiblissent parfois la tenue des plants au point de les faire verser. Lorsque les plants continuent leur croissance à la verticale, la tige prend alors la forme typique d’un « col d’oie ». Une rotation des cultures est suffisante pour éviter les dégâts de cet insecte. D’autres méthodes de lutte existent, telles que le maïs exprimant des protéines insecticides (ex. : maïs Bt), mais elles doivent être utilisées judicieusement pour retarder le développement de la résistance des insectes.
Quelques insectes s’attaquant aux parties aériennes du maïs sont particulièrement à surveiller en juillet et durant les mois suivants. Le ver-gris occidental des haricots (VGOH) est bien présent dans les champs de maïs du Québec, particulièrement en sols sableux. Ce papillon pond des masses d’œufs sur les feuilles de maïs, dans le haut du plant, à la sortie des croix. Dès la fin de juillet et au cours du mois d’août, il faut examiner les feuilles du haut des plants à contre-jour pour vérifier la présence de masses d’œufs. Plus tard en saison, si les larves causent des dommages considérables aux grains, des mesures de prévention peuvent être planifiées pour les années suivantes, telles que l’utilisation de certains hybrides de maïs Bt. Attention : les captures de papillons dans les pièges à VGOH sont parfois impressionnantes, mais elles ne sont souvent pas suivies de pontes aussi importantes. Le dépistage des masses d’œufs est donc essentiel.
Un autre ravageur à surveiller est la pyrale du maïs. Depuis l’introduction du maïs Bt, cet insecte cause peu de dommages au maïs de grande culture. Cependant, quelques populations résistantes ont récemment été répertoriées au Canada. Il est donc prudent de surveiller ses champs, même ceux de maïs Bt-pyrale, en vue de déceler rapidement les cas potentiels de résistance et d’agir en conséquence. Les larves de la pyrale du maïs s’attaquent à toutes les parties aériennes du plant. Le signe le plus évident de dommages est une tige cassée sur laquelle on observe un trou d’entrée de l’insecte.
Les maladies foliaires
Certaines conditions météorologiques favorisent des maladies foliaires, notamment des pluies fréquentes ou abondantes, des températures diurnes modérées et une humidité relative élevée.
La maladie appelée « dessèchement » est caractérisée par des lésions beiges allongées, en forme de cigare. Certains hybrides ont une sensibilité accrue à cette maladie. Si l’hybride est sensible et que la maladie apparaît tôt, les pertes de rendement peuvent être importantes.
La kabatiellose est relativement fréquente, surtout dans les champs de maïs sur précédent de maïs, en travail réduit du sol, mais elle cause rarement des pertes de rendement. Elle est caractérisée par de petites taches beiges (de 1 à 4 mm) avec un contour allant du pourpre au brun, entourées d’un halo jaune. Les taches peuvent se fusionner pour couvrir une plus grande surface foliaire.
La rouille commune n’est généralement pas préoccupante, car les spores ne survivent pas à nos hivers, sauf exception. La maladie arrive par les vents qui transportent les spores du sud, et donc l’infection se produit plus tard en saison, causant peu de dégâts.
La tache goudronneuse, détectée pour la première fois dans plusieurs champs de maïs en septembre 2024, est particulièrement à surveiller. Cette maladie se manifeste par de petites taches noires lustrées, légèrement surélevées, de forme ronde ou ovale. Elles sont impossibles à déloger lorsqu’on les gratte et ne tachent pas les doigts. Elles se retrouvent surtout sur ou sous les feuilles, mais peuvent aussi être observées sur d’autres parties des plants de maïs. Aucun hybride n’est complètement résistant à la tache goudronneuse, mais certains le sont en partie. Le choix de l’hybride constitue donc un bon moyen de prévention.
Finalement, il est important de noter les signes de carences possibles. La carence en azote, par exemple, apparaît dans le bas des plants sous la forme d’un « V » inversé jaune sur le bout de la feuille. Cette carence peut être présente dans l’ensemble du champ ou seulement dans certaines zones. Attention : dans plusieurs cas, il est normal d’observer des feuilles du bas jaunies. Il est recommandé de noter la répartition et la sévérité du symptôme et d’en discuter avec un conseiller.
L’importance de surveiller et de prévenir
Mieux vaut détecter les problèmes dès qu’ils apparaissent dans les cultures pour mettre en place certaines mesures dès l’automne ou au cours de la saison suivante. Bonne tournée des champs!
Pour recevoir de l’information spécifique aux grandes cultures tout au long de la saison, abonnez-vous gratuitement au Réseau d’avertissements phytosanitaires – Grandes cultures : www.agrireseau.net/rap.