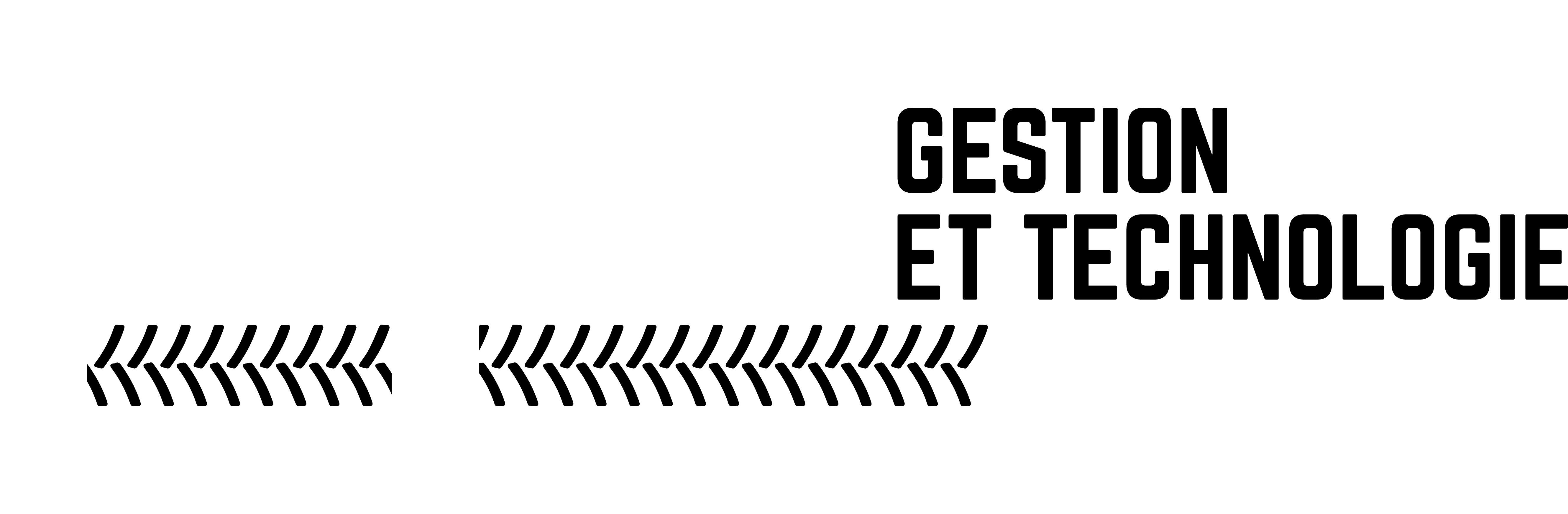GTA : De quelle manière concrète le CSF intervient-il dans le développement de politiques regardant l’avancement de la cause féminine, plus précisément en agriculture?
Me Louise Cordeau : Le Conseil peut œuvrer de différentes façons. Il peut être amené à déposer des mémoires ou à témoigner en commission parlementaire au sujet d’un projet de loi, par exemple, ou remplir des mandats assignés par la ministre ou le gouvernement portant sur des sujets précis. Le CSF peut aussi lancer des travaux de sa propre initiative sur des enjeux pertinents, notamment sur la relève féminine en agriculture et le portrait général des agricultrices du Québec.
Lors de mon arrivée en poste, les agricultrices sont devenues une préoccupation importante puisque j’ai grandi dans un environnement agricole, plus précisément dans la région de Saint-Hyacinthe. Mon père, Fabien Cordeau, a été député provincial du comté et secrétaire de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe durant cinq ans. Je connais bien ce milieu.
GTA : Est-il raisonnable de croire que l’agriculture est le milieu dans lequel on retrouve davantage de zones grises, de contextes ne respectant pas les principes d’égalité?
L.C. : J’ai envie de retourner la question (rires). Ce n’est pas le seul où l’on retrouve des zones grises. Je pense, entre autres, au milieu de la construction. Pour moi, si le milieu agricole doit en être un d’égalité, il doit aussi faire preuve d’équité. Chaque personne qui désire œuvrer dans ce milieu doit être en mesure de le faire. C’est effectivement un secteur d’activités où subsistent encore des préjugés et des stéréotypes. Le poids des traditions familiales est encore souvent très présent, telle l’idée du transfert de la terre de père en fils.
On demande encore trop souvent aux agricultrices qui opèrent de la machinerie lourde ou qui se rendent dans les encans ou les lieux d’approvisionnement : où est ton père, ton mari, ton cousin? La vision des rôles des hommes et des femmes en agriculture comporte aussi encore des préjugés en matière de conciliation travail-famille, et cela est devenu un enjeu important. Les droits communs sont reconnus, mais la manière dont ils existent dans la réalité est parfois autre chose.
DU CHANGEMENT À L’HORIZON?
GTA : Au cours des derniers mois, deux communications ont certainement contribué à éveiller bien des esprits : le calculateur des heures invisibles à la ferme et un autre démontrant l’importance pour les agricultrices de bien se protéger légalement et financièrement, de ne pas craindre de revendiquer ce qui leur revient de plein droit. Vos commentaires.
L.C. : Le CSF n’a pas mené d’étude précise sur cet enjeu, mais l’enjeu du travail invisible en est un que détaille l’AFEAS depuis longtemps. L’arrivée du calculateur vient certainement quantifier la valeur du travail des agricultrices et des conjointes d’agriculteurs. En agriculture comme pour plusieurs organismes, si les femmes ne s’engageaient pas en tant que bénévoles, plusieurs entités cesseraient d’exister. Connaître ses droits, c’est bien, mais se protéger, c’est mieux. Pouvoir évaluer le travail accompli de manière invisible est certainement un pas important.
GTA : Quel constat dressez-vous de l’évolution des mentalités, des changements en matière de droit et de politiques visant les femmes en agriculture?
L.C. : L’évolution des mentalités est quelque chose qui s’accomplit progressivement. Elle passe par le fait de valoriser la contribution des travailleuses de l’agriculture et en démontrant la contribution essentielle de celles-ci. On sait que les femmes désirant vivre de l’agriculture ont des pratiques innovantes. On sait également que la relève agricole est de plus en plus adéquatement formée.
Cela passe aussi par une intégration de la féminisation des titres. Par exemple, on parle encore aujourd’hui dans les médias de « producteur de lait », comme s’il n’y avait pas de « productrice ». Ça peut ressembler à un détail, mais en réalité, cela fait partie d’un ensemble de choses à changer, question de reconnaître et de valoriser nos agricultrices. Autre élément de réponse : l’intégration de femmes au sein de conseils d’administration et de hautes instances n’a certainement pas atteint la parité dans le milieu agricole. Par exemple : le conseil exécutif de l’UPA ne compte qu’une femme parmi les 7 membres. Au conseil général, on parle de 3 femmes sur 14 membres. Au niveau des présidentes et présidents de secteurs, on recense 4 femmes sur 25 sièges. Voilà un reflet de la réalité vécue par les agricultrices.
POUR LA PRISE DE CONSCIENCE
GTA : Y aurait-il lieu de mener une campagne télévisuelle / imprimée choc pour faire avancer les choses plus rapidement, pour rejoindre non plus seulement les agricultrices concernées, mais la société en général afin de susciter une prise de conscience collective?
L.C. : Sensibiliser la population aux réalités vécues par les femmes fait partie de notre mission. En 2019, nous avons lancé un balado, Paroles d’agricultrices, qui donne la chance aux différentes femmes de parler de leur expérience, de leur vécu. Nos réseaux sociaux permettent aussi de diffuser de l’information et de recueillir des commentaires. Tout cela est très important et très utile, et gagne à être connu et reconnu.
GTA : Quels sont les dossiers particulièrement importants pour le CSF sur l’horizon 2025-2026?
L.C. : Nous avons célébré en 2023 le 50e anniversaire de fondation du CSF, ce qui a donné lieu à différentes activités, dont une exposition itinérante qui fait le tour du Québec et la publication d’une bande dessinée intitulée Cap Égalité, produite en collaboration avec l’autrice et illustratrice Anne Villeneuve, qui vise les 10 à 12 ans. Un documentaire, Les Héritières, a aussi été produit.
De la même manière, nous avons révisé les 300 recommandations du rapport Pour les Québécoises : égalité et indépendance, qui a posé les bases de plusieurs politiques publiques en faveur de l’égalité femmes-hommes en 1978. En est sorti le rapport L’égalité entre les femmes et les hommes : Regard sur 50 ans d’évolution au Québec, qui porte sur les progrès réalisés et les défis qui persistent. Ce document résonne fortement actuellement. Tout comme la publication de notre Avis sur l’intelligence artificielle : des risques pour l’égalité entre les femmes et les hommes, qui met en relief les risques que des systèmes d’intelligence artificielle reproduisent et accentuent des inégalités entre les femmes et les hommes.