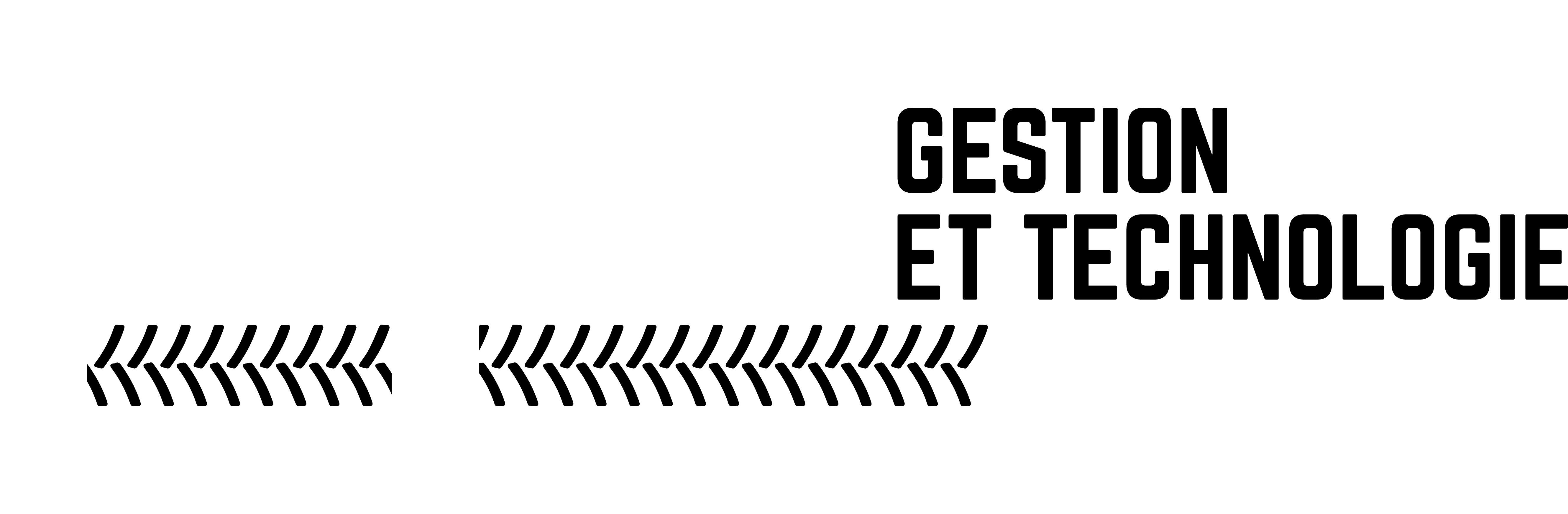Au Québec, on retrouve deux espèces de kiwis nordiques : Actinidia kolomikta et Actinidia arguta. La première est plus rustique et produit des fruits de la mi-août au début septembre. La deuxième, moins rustique, produit de plus gros fruits plus tard en saison, soit vers la fin septembre ou le début octobre.
Présente dans plusieurs régions du monde, dont le nord-est des États-Unis et la France, cette culture émergente gagne en popularité au Québec, principalement dans quatre régions : la Montérégie, Lanaudière, la Chaudière-Appalaches et l’Estrie. La culture se fait actuellement sur de petites superficies dans la province, majoritairement sur moins d’un hectare.
Bien que ce fruit soit intéressant pour diversifier une entreprise et possède un bon potentiel de croissance, il est important de considérer certains éléments avant de songer à démarrer une telle production.
Le rendement
L’un des attraits de cette culture est son potentiel de rendement. Au New Hampshire, un plant d’Actinidia arguta peut produire jusqu’à 23 kg (50 lb) de fruits en une saison, ce qui est très intéressant. Cependant, cette donnée peut difficilement être transposée au Québec, car le potentiel de rendement réel selon nos conditions est encore méconnu. Premièrement, la majorité des plantations sont encore trop jeunes pour donner un portrait juste des rendements à maturité. Deuxièmement, l’itinéraire technique n’est pas encore au point. En effet, bien que ce fruit soit cultivé de l’autre côté de la frontière, plusieurs paramètres sont à optimiser en fonction de notre climat plus froid, notamment la fertilisation, l’irrigation, le choix des cultivars rustiques et performants, la gestion post-récolte, etc. D’ici là, le rendement ne risque pas d’être à son plein potentiel.
L’offre et la demande
Pour le moment, l’offre locale ne suffit pas à la demande. C’est positif et ce n’est pas le cas de toutes les cultures fruitières. Les fruits sont majoritairement écoulés à la ferme ou dans les marchés locaux. Avec le temps, d’autres entreprises pourraient saisir l’occasion de démarrer une telle production. Dans cet esprit, il est recommandé de bâtir un plan d’affaires qui tiendra compte de la concurrence possible et de la fluctuation du prix de vente.
Les défis agronomiques
Cette culture en comporte plusieurs. Le défi majeur actuel est la protection contre le gel. Au printemps, les nouvelles pousses gèlent à -3 °C et les feuilles à -1 °C. Voilà des températures fréquemment observées à ce temps de l’année au Québec. Les fruits sont aussi fragiles à des températures de -1 °C, ce qui peut s’avérer un problème en cas de gelées hâtives à l’automne. Dans certaines régions, le gel hivernal peut aussi endommager les plants. Le kiwi étant une plante vigoureuse, ces gelées tuent rarement les plants, mais auront une grande incidence sur la vigueur et le rendement, non seulement de l’année en cours, mais aussi des suivantes. Pour rendre cette culture résiliente, il faudra perfectionner les moyens de lutte contre le gel, notamment en adaptant des techniques utilisées dans d’autres cultures fruitières. Le choix du site est également très important, car le kiwi n’aime pas du tout le vent, ni avoir les pieds dans l’eau.
L’entretien
Cette culture requiert un investissement considérable en temps. Le kiwi étant une plante très vigoureuse qui produit plusieurs lianes, il faut consacrer beaucoup de temps à la taille et à la conduite des plants en vue d’obtenir un rendement intéressant. En plus de la taille en dormance, il est requis de tailler quelques fois en saison et de palisser régulièrement les tiges pour éviter qu’elles ne s’entortillent entre elles ou autour des fils. Le temps nécessaire pour la taille et la conduite des tiges serait estimé à 0,5 heure par plant par année, soit environ 500 heures par hectare par année1. Ce chiffre ne tient pas compte de toutes les autres opérations nécessaires dans le verger ni du temps requis pour effectuer la récolte et le tri lorsque le verger est en production. Il faut donc prévoir une main-d’œuvre suffisante.
L’investissement financier
Comme plusieurs cultures pérennes, celle-ci demande de soutenir de grands investissements pendant plusieurs années avant d’obtenir un revenu. Les investissements sont d’autant plus importants sachant qu’un système de palissage solide est nécessaire pour soutenir le poids des tiges et des fruits. De plus, l’ajout d’un système d’irrigation est essentiel puisque les besoins en eau sont élevés. Dans le meilleur des scénarios, les plants peuvent commencer à produire après trois ou quatre ans, mais pour certaines variétés, il faut attendre de cinq à sept ans. Par ailleurs, pour assurer la pollinisation, il faut planter un plant mâle pour six plants femelles. Environ 15 % des plants de la parcelle ne seront donc pas productifs.
En conclusion, le kiwi nordique est une culture émergente très intéressante qui présente un bon potentiel de croissance et apporte une diversification de l’offre fruitière locale. Il faut seulement garder en tête que les défis agronomiques sont encore grands pour cette culture et que la rentabilité n’est pas garantie à court terme. Avant de se lancer, il est important d’établir un plan d’affaires réaliste et de consulter un conseiller en gestion au besoin.
1 HASTING, William, et Iago HALE (2019). Growing Kiwiberries in New England: A Guide for Regional Producers.