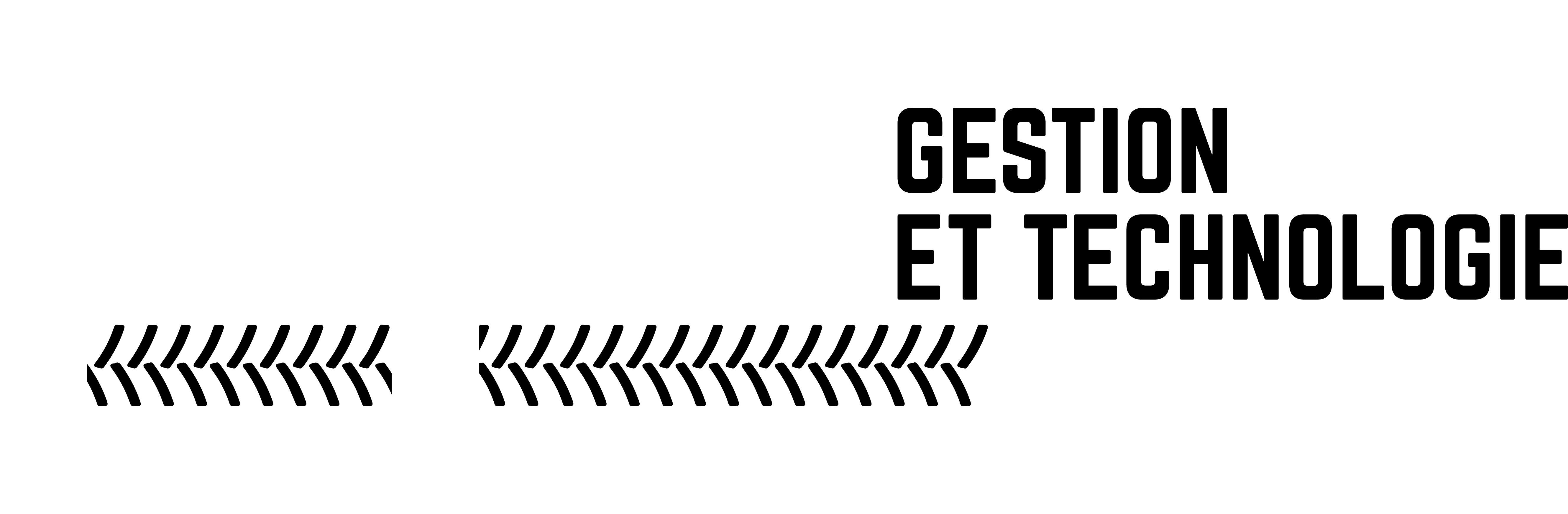GTA : Concrètement, en quoi le changement juridique de 2022, en devenant un OBNL, a-t-il changé vos méthodes et pratiques en cours?
Maxime Mercet : Il y a eu une prise d’indépendance, un changement de gouvernance par rapport au CEROM, qui gérait le RGCQ parmi d’autres entités. Nous avons donc un nouveau conseil d’administration, bien que les protocoles et les comités indépendants soient demeurés les mêmes. Leur mission est toujours d’instaurer des protocoles rigoureux afin de réaliser leurs tâches, qui demeurent la réalisation des essais de performance et, pour le comité Céréales, l’enregistrement auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). C’est dans le but de renforcer cette autonomie que le RGCQ a décidé d’opter pour ce changement administratif en 2022. La mission et la détermination présentes depuis plus de 50 ans restent les mêmes.
GTA : D’où vient le financement du RGCQ, mis à part du MAPAQ?
M.M. : Les parrains représentent environ 85 % du financement. Si le MAPAQ ne compte que pour environ 10 % à 15 %, il faut souligner que ces fonds se révèlent très importants pour le RGCQ. Nous espérons voir ce financement être bonifié sous peu, car il est demeuré le même depuis 2004. Les effets combinés de l’inflation depuis cette époque et de la demande pour élargir et consolider nos activités nécessitent une révision à la hausse de notre budget total, soit de 20 % à 30 %.
Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) sont aussi des partenaires fidèles qui contribuent à hauteur de 5 % à notre budget opérationnel. Comme les PGQ financent selon un effet de levier de 30 % par rapport au MAPAQ, une révision du budget par le Ministère se solderait aussi par une hausse de la contribution des PGQ.
Pour rappel, en 1994, le MAPAQ et Agriculture et Agroalimentaire Canada finançaient en quasi-totalité les 11 réseaux d’essais existants à l’époque. Sans vouloir retrouver ce niveau-ci, il s’agirait plutôt pour les institutions qui nous accompagnent de se positionner clairement et d’envoyer un message fort : le gouvernement soutient le développement durable, l’innovation agricole et il aide à la pérennisation du RGCQ, garant de ce système d’évaluation neutre et indépendant, si utile aux producteurs de grains et aux Québécois.
GTA : Comment se détaille votre structure opérationnelle en tant qu’OBNL?
M.M. : Le RGCQ n’a pas d’employés. Il opère en collaboration avec des prestataires de services, des partenaires, qui facturent leurs services. En tant que directeur général, je ne suis pas salarié, mais considéré comme consultant. Les administrateurs sont bénévoles. Les coordonnateurs, comme je l’expliquais, sont des professionnels qui facturent leurs services. Le RGCQ peut compter sur des collaborateurs fidèles, dont certains comptent 30 ans de service : Julie Durand, qui gérait le réseau Maïs, s’occupe maintenant des céréales d’automne; Jean Goulet est responsable du blé de printemps panifiable; Martin Lacroix supervise le soya, l’avoine, l’orge et le canola; puis Jean-Marc Montpetit, arrivé plus récemment, est le responsable du volet maïs-grain.
UN PLAN QUINQUENNAL CHARGÉ
GTA : Pour celles et ceux qui vous connaissent peu ou pas assez, pourriez-vous définir vos activités quotidiennes?
M.M. : Certainement. En tant que directeur général, je veille à la bonne gouvernance du Réseau afin de toujours obtenir le soutien de nos nombreux partenaires, de nos parrains. Je m’assure également que les services rendus soient de premier niveau. Je suis également responsable des relations avec les universités avec lesquelles nous collaborons sur des projets de recherche, avec les responsables de sites d’essai de même qu’avec les membres du CA, question de veiller à ce que les intérêts du RGCQ priment sur tous les processus et décisions.
GTA : La mission du RGCQ est vaste. Au nombre de ses objectifs, on recense celui d’augmenter sa présence et sa proactivité auprès des instances gouvernementales et sectorielles. À ce jour, quel est le constat?
M.M. : Nous avons récemment publié notre plan stratégique 2025-2030. À partir de là, il importe de garder des contacts étroits avec l’ensemble des intervenants du milieu, question de toujours être au fait des besoins et de pouvoir orienter les services en ce sens. Cela va des PGQ au Groupe de concertation du secteur des grains du Québec en passant par le MAPAQ, les semenciers du Québec et plusieurs autres.
Un des moyens visant à souligner l’importance du RGCQ au sein de l’industrie tient certainement dans la publication du Guide du Réseau des grandes cultures du Québec, un outil incontournable pour les producteurs de grains afin de les aider à choisir de façon neutre et éclairée les semences qui conviennent le mieux à leur entreprise.
Pour plusieurs producteurs, ce guide interactif constitue « une bible ». Cela dit, le RGCQ espère rencontrer sous peu le nouveau ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, afin de l’informer de notre mission, de notre position stratégique, de nos besoins et de notre contribution à l’économie québécoise de même qu’à l’objectif d’autonomie alimentaire.
GTA : Le nombre actuel de parrains suffit-il aux besoins?
M.M. : Non. Les parrains qui nous sont fidèles depuis plusieurs années possèdent leurs propres matériel et processus de recherche et développement budgétés et calibrés. Ils n’auront pas subitement trois fois plus de besoins ou de lignées à inscrire. Alors oui, avoir davantage de parrains serait idéal, mais un financement accru serait nécessaire pour assurer les essais et les évaluations supplémentaires.
GTA : Parle-t-on toujours de 20 000 parcelles expérimentales évaluées annuellement?
M.M. : On parle toujours de 15 000 à 20 000 parcelles évaluées par année. Le RGCQ souhaite hausser ce nombre, notamment à travers un partenariat avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et avec un site qui relève de l’Université de Guelph, situé à New Liskeard en Ontario. Le Réseau tient vraiment à développer son offre dans les régions périphériques.