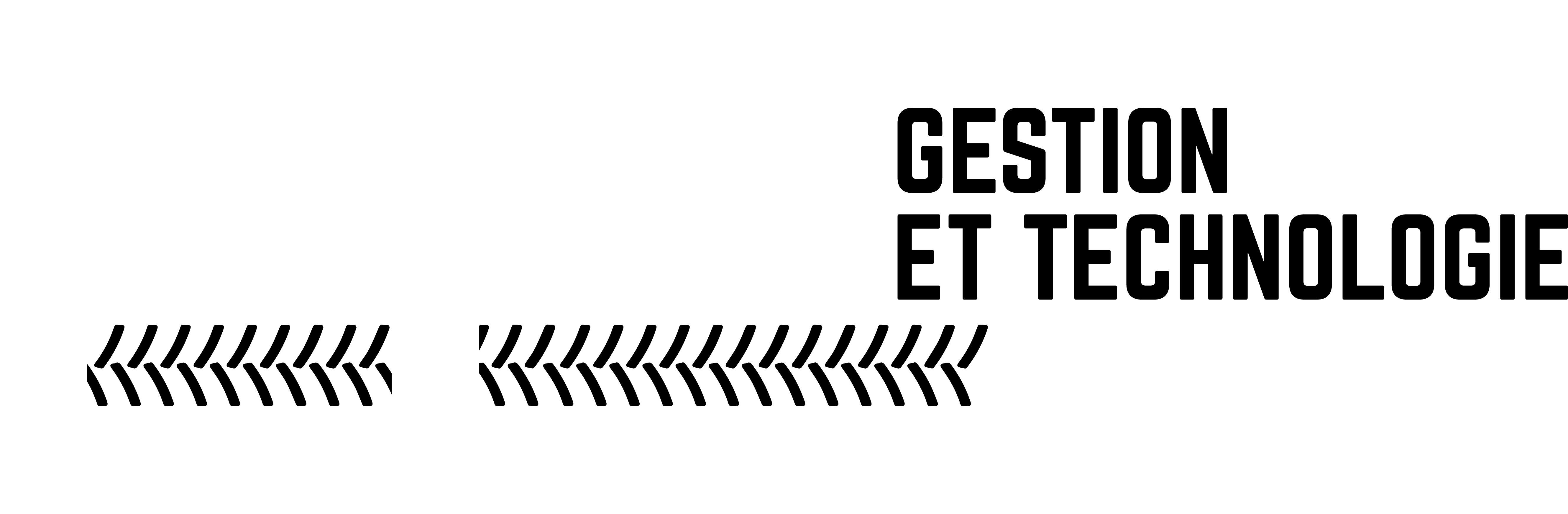Pour avoir un coup d’avance sur les indésirables qui se retrouvent dans les productions horticoles en serre voici sept astuces à mettre en place.
1. Connaître les insectes ennemis les plus fréquents en cultures en serre et l’historique d’infestation
Pucerons, thrips, tétranyques à deux points et aleurodes sont des organismes qui s’attaquent à plusieurs cultures et qui se multiplient rapidement. Les connaître et être en mesure de les identifier en cours de saison facilite le travail pour les éliminer. Plusieurs ressources gratuites sont mises à la disposition des serriculteurs pour leur permettre d’acquérir des connaissances sur le sujet, comme les communiqués du Réseau d’avertissements phytosanitaires (www.agrireseau.net/rap/) pour les cultures maraîchères, fruitières et ornementales en serre et le site Web IRIIS phytoprotection (www.iriisphytoprotection.qc.ca).
Il est important de garder l’historique des infestations puisqu’il renseigne sur les ennemis qui sont les plus susceptibles de revenir. Ces données permettent de planifier les commandes de prédateurs en choisissant les mieux adaptés au site. Lorsque l’historique n’est pas connu, la planification repose seulement sur les ennemis les plus fréquents et non sur la situation réelle du site.
2. Passer les commandes à l’avance auprès de son fournisseur
Il est recommandé de planifier l’achat des prédateurs avant le début de la saison et de s’entendre avec le fournisseur sur les dates de livraison, afin d’être prêt à les introduire au bon moment et à la bonne fréquence. Ceci évite le retard dans l’introduction des prédateurs, qui peut être attribuable à la charge de travail en cours de saison. Un autre avantage est d’obtenir une estimation des coûts à venir.
Pour discuter des meilleurs choix d’agents de lutte avec le fournisseur, le document : la Charte de décision pour auxiliaires biologiques est un outil précieux. Sous forme d’affiches, elle est accessible gratuitement sur le site du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (www.craaq.qc.ca/).
Elle a été réalisée conjointement par le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel, le MAPAQ et les principaux fournisseurs d’agents de lutte.
3. Choisir la bonne dose d’introduction
Une erreur courante est d’opter pour une dose insuffisante ou de demeurer à une dose préventive plutôt que curative lorsque la situation change. À titre d’exemple, pour lutter contre le thrips du tabac, la dose préventive de l’acarien Amblyseius swirskii est de 20 individus par mètre carré, alors que cette dose grimpe à 100 individus par mètre carré en contexte curatif. Il est donc important d’ajuster le calendrier des commandes en fonction de l’évolution des ennemis des cultures observée en cours de saison.
4. Vérifier la viabilité des auxiliaires de lutte et les introduire rapidement
Il faut d’abord s’assurer que les organismes achetés sont bien vivants au moment de la réception. La première étape est de vérifier l’état de la boîte, son odeur et sa température. En cas de doute ou de mortalité, il faut communiquer avec le fournisseur.
Pour conserver l’efficacité des agents de lutte, ils doivent être introduits rapidement, idéalement dès la réception si les conditions le permettent. Si ce n’est pas possible, il est recommandé d’insérer un bloc réfrigérant dans la boîte contenant les auxiliaires de façon à garder la température interne de la boîte entre 15 et 30 °C.
Pour mieux connaître les manières de contrôler la qualité des produits, il est possible de visionner la vidéo Vérification de la viabilité des auxiliaires à leur arrivée de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (www.iqdho.com/videos/).
5. Donner les meilleures conditions pour le développement des auxiliaires de lutte
On doit s’assurer que l’environnement est adéquat pour le développement des auxiliaires en termes de température, d’humidité et d’heures de lumière.
La charte décisionnelle contient des informations relatives aux conditions environnementales nécessaires. Elle informe aussi sur la compatibilité et l’incompatibilité des auxiliaires entre eux et avec l’utilisation de différents produits phytosanitaires. En effet, quelques insecticides peuvent être appliqués sans nuire à certaines espèces de prédateurs. Par exemple, il est possible de combattre des pucerons avec un produit à base d’huile minérale sans trop nuire aux coccinelles.
6. Dépister en cours de saison pour ajuster le tir
Un dépistage régulier permet de détecter la présence de nouveaux ennemis, d’évaluer l’évolution de ceux déjà constatés et de vérifier l’efficacité des méthodes de contrôle employées.
Comme mentionné plus haut, si l’on remarque la présence d’un insecte nuisible pour lequel on avait introduit une dose préventive, c’est le signal qu’il faut passer en dose curative.
Si l’on constate que l’agent de lutte ne semble pas efficace, il est probable que les conditions ne soient pas adéquates pour qu’il se développe. Le manque d’humidité ou l’excès de chaleur sont souvent les causes du problème.
L’autre hypothèse en cas d’échec de contrôle est que l’auxiliaire de lutte n’est pas adapté à l’espèce nuisible. Par exemple, Aphidius colemani est une guêpe qui parasite plusieurs espèces de pucerons, dont le très fréquent puceron vert du pêcher, en pondant ses œufs dans le corps de ses hôtes. Cette espèce de guêpe ne parvient cependant pas à « momifier » le puceron de la pomme de terre.
En cas de doute sur l’identification, il est utile d’envoyer un échantillon au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ. Le résultat permettra de choisir l’agent de lutte adapté.
Le dépistage permet aussi de prendre des décisions selon les insectes bénéfiques observés qui peuvent s’introduire naturellement dans les serres comme des coccinelles, des larves de cécidomyies et des larves de syrphes.
7. Acquérir le bon matériel
Une loupe dont le grossissement est de 10 fois est un outil indispensable et peu coûteux qui facilite grandement le dépistage et la vérification des agents de lutte au moment de leur réception. Il est aussi utile de prévoir des pots et des sacs refermables pour capturer les insectes afin de faciliter leur identification ou de les envoyer au laboratoire.
Pour toute question concernant la lutte biologique, contactez votre conseiller et vos fournisseurs d’auxiliaires.